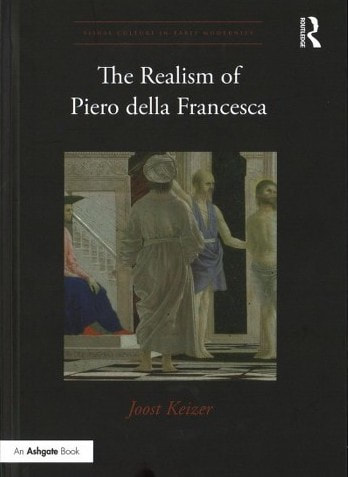|
Joost Keizer
The Realism of Piero della Francesca Londres et New York, Routledge (Ashgate), 2018 145 pp. 150 $US (relié) ISBN : 9781472461315 49.46 $US (livre électronique) ISBN : 9781315553641 Le débat fait toujours rage, en histoire de l’art comme dans toutes les disciplines historiques. D’un côté, les historicistes espérant reconstituer le « Period Eye » rêvé par Michael Baxandall ; de l’autre, les spécialistes du passé reconnaissant la complexe temporalité de l’écriture historique et l’importance d’un savoir « situé », et accueillant par conséquent favorablement l’anachronisme à la Georges Didi-Huberman ou la « preposterous history » développée par Mieke Bal. Joost Keizer, jeune vedette de l’histoire de l’art « early modern » et spécialiste des artistes hautement canoniques tels que Michel-Ange et Léonard de Vinci, ne semble pas apriori aspirer au statut d’intervenant majeur dans ce débat théorique ; le foncièrement archaïque Piero della Francesca n’est pas le candidat le plus évident pour faire l’objet d’une histoire de l’art cherchant à relier les enjeux du passé avec les débats du présent, mettant de l’avant la pertinence d’une lecture du XVe siècle à travers les lentilles du XXIe. En effet, Keizer ne se positionne pas explicitement sur cette controverse méthodologique et historiosophique et ne fait aucune mention de son propre temps d’historien, de son – de notre – présent. Et pourtant, entre les lignes se devine un questionnement tout particulier de l’art de Piero qui, en fin de compte, nous dit quelque chose sur les enjeux qui nous intéressent en 2018. C’est connu, banal, discuté ad nauseam : nous vivons à l’ère de la mondialisation, de la globalization dans le « Globish » qu’est devenu l’anglais ; et, en même temps, des enjeux locaux, des identités géographiquement spécifiques, des luttes précisément situées refont surface à travers et à l’encontre de cette homogénéisation planétaire. Le concept du glocal a été forgé justement pour donner un nom à cette étrange tension. Et Piero della Francesca, au milieu du XVe siècle, est, à en croire Keizer, l’artiste glocal par excellence, quoiqu’avant la lettre. Qu’il était un artiste « universel », nous le savions déjà : un grand théoricien, lu et apprécié jusqu’à loin de chez lui, et un peintre rigoureux, mathématique, une somme de la culture humaniste – c’est-à-dire paneuropéenne – de son temps. Ce qu’ajoute Keizer à ce portrait, c’est l’élément fortement local, l’ancrage provincial et temporel, et l’interaction fructueuse entre l’universel et le spécifique qui, au lieu de former une contradiction, créent l’artiste riche et complexe qu’était Piero. En étant local, Piero est également un artiste du peuple, n’appartenant qu’à moitié à une élite détachée d’humanistes savants ; un autre courant historiographique actuel, celui des « histoires populaires » (la People’s History, inventée par Howard Zinn), se reflète ici, peut-être à l’insu de l’auteur. L’étude, se présentant d’emblée comme une monographie générale sur l’artiste, s’avère plutôt une analyse concentrée, concise mais détaillée d’une œuvre phare de l’artiste : La flagellation d’Urbino (vers 1455–1460). Si d’autres œuvres sont mentionnées, voire reproduites, elles ne le sont qu’à titre de confirmation ou de contre-exemple ; et certaines des peintures les plus emblématiques de Piero – on pense à L’Annonciation de Pérouse, terrain de jeu préféré des historiens de la perspective – ne sont jamais abordées. C’est à travers le concept de « réalisme » que Keizer définit l’art du peintre, sa description d’une « expérience spécifique, personnelle et intime de la réalité » (p. 4 ; c’est moi qui traduit toutes les citations). L’art de Piero ne décrit rien d’autre que « le monde de Piero ». Le choix terminologique de Keizer, déjà dans le titre, pose problème, et il le sait. Tôt dans le livre, il s’explique : le choix de « réalisme » – et non pas, par exemple, celui du terme plus courant, mais tout aussi problématique, de « naturalisme » – a à voir avec l’étymologie du mot, son lien avec le res latin. C’est l’association avec les choses concrètes qui prime ici. L’argument est plausible, mais l’observation, formulée plus loin (p. 67), qu’aujourd’hui la distinction entre « réalisme » et « naturalisme » est que celui-ci « décrit l’imitation de quelque chose qui n’est pas réel comme s’il était imité à partir de la réalité » alors que celui-là « imite exclusivement la réalité contemporaine » suppose un consensus là où il n’en existe pas et simplifie trop ce débat passionnant. Si les choses étaient si simples, les débats intenses autour de l’art de Caravage, par exemple, n’auraient pas lieu d’être. Parlant du réalisme, il arrive à Keizer de s’exprimer par un discours indirect libre qui nous empêche de savoir qui parle vraiment et qui déclare certaines choses. Quand il dit que « le réalisme est l’antithèse du style » (p. 7), on l’imagine mal croire vraiment à cette affirmation naïve, surtout qu’il nous assure un peu plus loin qu’en réalité le réalisme n’empêche pas l’apparition d’un style. Pourtant, on n’est pas certain de comprendre au nom de qui ce truisme est énoncé. Dans la même veine, l’auteur utilise parfois des verbes d’énonciation verbale (dire, affirmer) pour décrire ce que fait un peintre dans ses œuvres picturales. La métaphore est intéressante, mais demande à être explicitée et justifiée si l’on ne veut pas réduire une peinture à un « message ». Après avoir clarifié ses intentions dans l’introduction – se situant ainsi brillamment dans un champ historiographique abondant, succinctement synthétisé en quelques pages – Keizer consacre les quatre chapitres de son étude à la démonstration de ce « réalisme » et de son ancrage dans la théorie artistique explicite de Piero. C’est justement à cette dernière tâche que s’attelle le premier chapitre, lisant les textes de Piero pour y trouver sa « méthode » de peinture, et en particulier sa vision de la perspective (le chapitre est intitulé « Before the work », même si les écrits analysés sont, chronologiquement, d’une période tardive dans la carrière du peintre). La perspective est liée au « réalisme » puisqu’elle suppose un monde découvert par le peintre et non pas inventé ; un morceau de réalité plutôt qu’un produit de l’imagination. Elle a aussi le rôle de clarifier, pour les personnes qui regardent une peinture, l’espace dans lequel elles vivent. Le cœur de la démonstration – de l’argument par l’exemple – se trouve dans les chapitres 2 et 3 (« The time of the work » et « The site in the work ») où, respectivement, ce sont les portraits des contemporains et l’architecture du temps de Piero qui sont repérés dans les peintures (en en particulier dans La flagellation). Dans les deux cas, Piero crée un amalgame qui pourrait être perçu comme un paradoxe mais qui, dans les termes que l’on connaît entre autres depuis l’influent Anachronic Renaissance d’Alexander Nagel et Christopher Wood (2010), est bien ancré dans la logique historiographique, mais aussi théologique du XVe siècle. Les personnages connus personnellement de Piero apparaissent dans des scènes se déroulant dans l’antiquité ou tirées de l’histoire sainte ; et ces mêmes scènes ont comme décor une architecture clairement identifiée comme locale et actuelle en Italie de la Renaissance, particulièrement à l’Urbino des Da Montefeltro. Un art glocal, encore une fois : de portée universelle et grandiose, mais filtré à travers l’esthétique locale et la réalité quotidienne la plus banale entourant l’artiste. Suivant et surpassant la logique structurelle implacable qui va de l’infrastructure théorique sous-tendant l’œuvre aux peintures elles-mêmes, le chapitre 4 poursuit le trajet « After the work », vers sa réception et ses spectateurs. Mais la logique temporelle complexe de l’interprétation de Keizer fait que ce chapitre, pour ainsi dire, s’enroule sur lui-même. En narrant la place du type de peinture qu’est La flagellation dans l’évolution du tableau autonome moderne (Victor Stoichita et Michael Fried sont les références incontournables avec qui Keizer entame une discussion), l’auteur montre les limites d’une vision évolutive de l’art. Pour lui, Piero, plus qu’un artiste ouvrant la voie à la modernité, est un vrai héraut de la Renaissance, avec tout ce que ce mouvement culturel a de paradoxal, lui qui regarde vers un passé lointain pour amorcer une rénovation inédite. Et au-delà de cette position ambiguë entre passé et avenir, les œuvres de Piero sont aussi, peut-être surtout, de leur temps, du moment qui les a vues naître. Elles sont ancrées au présent moins par leur « style », nous dit Keizer à plusieurs reprises, mais plutôt par leur contenu, par ce qu’elles représentent, par le monde de l’artiste qu’elles incluent. Cette intimité entre l’artiste et sa création – et, par là même, entre l’œuvre et son public – est, en fin de compte, ce que l’auteur cherche à mettre de l’avant. S’il n’est pas toujours clair si pour Keizer Piero est un pur produit de son temps, représentatif de sa culture, ou au contraire un innovateur parfois inattendu voire mal compris (cette tension est patente à la p. 10, par exemple), l’ouvrage reste, un peu comme les peintures qu’il analyse, un excellent mariage du général et du spécifiquement concret. L’auteur nous offre un argument fort sur certains enjeux urgents de l’historiographie de la Renaissance – et, de surcroît, sur quelques questions que notre postmodernité se pose actuellement – tout en proposant de fines analyses picturales et une nouvelle lecture de l’artiste très concret qu’était Piero della Francesca. C’est une heureuse mise-en-abyme : en dépeignant Piero comme un artiste glocal, Joost Keizer a écrit une histoire de l’art qui, elle aussi, et tout à son avantage, cède aux charmes de la « glocalité ». Une histoire à fort ancrage temporel, mais à vocation universelle. Itay Sapir est professeur d’histoire de l’art à l’Université du Québec à Montréal. [email protected] Vertical Divider
|

|
|
|||
|
|