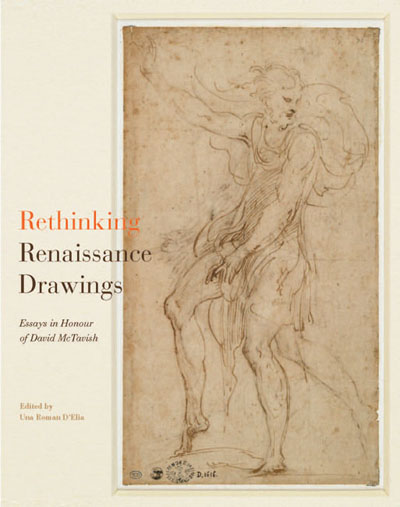|
Una Roman d’Elia, dir.
Rethinking Renaissance Drawings. Essays in Honour of David McTavish Montréal ; Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2015 409 pp., 147 illustrations en couleur 125.00 $, ISBN 9780773546363 Pour souligner l’apport majeur de David McTavish (1943–2014) à l’avancement des études sur le dessin de la Renaissance, Una Roman d’Elia a commandé des textes à plusieurs auteurs, dont de nombreux étudiants de McTavish, afin de composer cet ouvrage collectif publié à sa mémoire. Le sujet de cette publication permet de mettre en évidence la relation entre maître et apprenti (voir notamment Stowell, Hochmann, Dickey et du Prey) : un bel hommage des auteurs à leur défunt mentor. D’Elia est d’ailleurs professeure à l’Université Queen’s, à Kingston en Ontario depuis 2002, où McTavish a lui-même enseigné de 1973 à 2013. Canadien d’origine, McTavish a complété sa thèse de doctorat sur Giuseppe Porta, dit Salviati, en 1978 au Courtauld Institute of Arts de Londres, thèse qui fut ensuite publiée chez Garland en 1981. Premier catalogue raisonné de l’artiste, cette contribution a notamment permis de répertorier les dessins de Salviati. McTavish a ensuite étudié les dessins de nombreux autres artistes de la Renaissance et de l’époque baroque tels que Léonard de Vinci ou Annibale Carrache. Comme le souligne Allison Sherman dans la postface du volume, McTavish a contribué à la discipline en proposant plusieurs nouvelles attributions et en renouvelant les approches liées à l’interprétation du dessin. Il s’est notamment penché sur le rôle du dessin dans le travail d’atelier et sur son importance dans les échanges artistiques européens (297). Les vingt essais de cette publication ont été choisis et organisés selon cinq sections (New Discoveries ; Imagery of Renaissance Drawings – Sacred and Secular ; The Process of Drawing in the Renaissance – Theory and Practice ; The Collecting of Renaissance Drawings ; et Drawing from Renaissance to Baroque) dans l’objectif de refléter la variété de problématiques que McTavish a soulevées au cours de sa carrière et de repenser les études sur le dessin de la Renaissance, comme l’indique le titre de l’ouvrage. Le recueil se veut donc un héritage concret du travail de McTavish, ce que ne manque pas de souligner D’Elia dans son introduction, dans laquelle elle explique la place importante dévolue au dessin vénitien dans le livre (7). Cette prééminence constitue un écho certain à l’apport particulier de l’historien de l’art canadien à l’étude du médium dans cette région de l’Italie. La première section regroupe des articles qui s’attardent à des questions d’attribution, en hommage au travail méticuleux de McTavish dans ce domaine. Catherine Monbeig Goguel et David Franklin permettent l’augmentation du corpus d’artistes méconnus comme Agnolo di Donnino del Mazziere (Monbeig Goguel) ou le maître des Albums Egmont (Franklin). Paul Joannides, quant à lui, met en évidence la collaboration artistique de Michel-Ange avec Sebastiano del Piombo par l’attribution, à ce dernier, d’études préparatoires pour La résurrection de Lazare. Ces auteurs s’inscrivent ainsi dans une histoire de l’art basée sur le connoisseurship, une méthodologie théorisée dès le XIXe siècle par Giovanni Morelli. Ce faisant, Monbeig Goguel, Franklin et Joannides adoptent une manière d’approcher les œuvres héritée de McTavish. En revanche, il est difficile de considérer qu’ils renouvellent par ces articles l’étude du dessin. L’essai de Charles Hope montre toutefois que l’attribution est un outil précieux pour l’historien de l’art. En attribuant à Giulio Campagnola des dessins jusqu’alors donnés à Giorgione et à Titien, l’auteur réhabilite le génie créateur du dessinateur vénitien moins célèbre. En effet, les études antérieures ayant approché l’œuvre de Campagnola avaient relégué l’artiste au rang d’épigone, alors même que, comme le démontre Hope, il était admiré par ses contemporains bien davantage que Giorgione. En ce sens, son essai atteste de la pertinence de la première section de l’ouvrage, bien que les sections suivantes soient encore plus étoffées sur le plan théorique. Dans les trois articles de la deuxième section, les auteurs interrogent le sujet des représentations dessinées et leur fonction : la Samaritaine chez Michel-Ange pour Sally Hickson, les hommes célèbres chez Federico Zuccaro pour James Mundy et le baptême du Christ ou des saints pour Steven Stowell. Au sein de cet assemblage un peu hétéroclite, l’essai de Stowell se démarque par le traitement d’un corpus textuel plutôt que visuel. S’appuyant sur les théories anthropologiques d’Alfred Gell et de James George Fraser sur l’agentivité des œuvres d’art, Stowell propose que les dessins de scènes de baptême exercent, à la Renaissance, une agentivité sur les jeunes artistes qui les réalisent en contribuant à leur maturation artistique. Dans ses célèbres Vies d’artistes, Giorgio Vasari évoque régulièrement les dessins figurant un baptême en les situant à ce moment charnière de la carrière de l’artiste, particulièrement lorsqu’il s’agit d’une copie d’un maître plus expérimenté. Sa représentation dessinée du baptême permettrait ainsi à l’apprenti d’entrer dans la communauté artistique. Cette lecture convaincante de Vasari apporte un éclairage nouveau sur ses célèbres biographies en révélant une construction littéraire récurrente autour du dessin. L’article contribue par conséquent à l’avancée des connaissances concernant les croyances reliées à cet art à la Renaissance. De plus, parce qu’il traite du rôle de l’acte graphique dans l’apprentissage artistique, l’article de Stowell est particulièrement approprié pour faire le pont avec la troisième section, qui traite de manière approfondie de l’emploi du dessin au sein de l’atelier. Un thème important de cette troisième section, et qui revient régulièrement tout au long du volume, est celui de la copie. Michel Hochmann discute de l’usage de cartons pour copier des motifs et les réutiliser dans de nouvelles compositions au sein des ateliers vénitiens du XVIe siècle. Il s’agit d’une technique que Franziska Gottwald aborde également, en axant toutefois son argumentaire sur Perugino. Selon son hypothèse, l’utilisation d’une telle technique, par la linéarité qu’elle apporte aux œuvres de l’artiste, expliquerait en partie la sérénité qui s’en dégage. Sharon Gregory traite pour sa part de la reproduction d’œuvres d’autres maîtres comme participant au système d’invention de Perino del Vaga. Les articles de Catherine Whistler et Aimee Ng se distinguent en examinant respectivement la publication de manuels de dessins pour l’aristocratie vénitienne et l’effet de la pratique de la gravure sur les dessins de Parmigianino. Ce dernier article est fascinant par sa mise au jour des méthodes inusitées qu’utilise l’artiste, comme la reproduction d’un motif au dos du feuillet où il est dessiné dans l’objectif de le retravailler. Cette stratégie, qui inverse le motif, implique une connaissance précise des techniques de la gravure. Dans la quatrième partie de l’ouvrage, l’attention des auteurs se porte sur le collectionneur des dessins de la Renaissance, une autre allusion au travail de McTavish, cette fois-ci à son travail muséal, qui a permis d’accroître le collectionnisme des dessins de la Renaissance au Canada. Cette section aborde le collectionneur dans une perspective diachronique : des collectionneurs de dessins des contemporains de Raphaël (David Ekserdjian), jusqu’au collectionneur viennois du XXe siècle Benno Geiger (Sebastian Schütze), en passant par les collectionneurs français du XVIIIe siècle (Cathleen Hoeninger). Ce dernier article, qui interroge les raisons du collectionnisme des dessins des « primitifs italiens », art peu valorisé avant la moitié du XIXe siècle, parmi les collectionneurs français du XVIIIe et du début du XIXe siècle, est sans conteste le plus riche de la section. Hoeninger compare les politiques d’acquisition de Pierre Crozat (1665–1740) – qui possédait 19 200 dessins ! –, et de Jean-Baptiste Wicar (1762–1834). Même si Wicar élabore sa collection plusieurs décennies après Crozat, les dessins sont acquis dans les deux cas pour leur provenance célèbre, soit leur appartenance antérieure à la collection de Vasari lui-même, ou à celle d’autres collectionneurs reconnus comme Sebastiano Resta (1635–1714). Cette contribution apporte ainsi un éclairage nouveau sur la fortune critique des dessins des « primitifs italiens » dans les siècles suivants. Dans son introduction à la dernière section, Una Roman d’Elia met de l’avant la continuité d’enjeux liés au dessin de la Renaissance aux XVIIe et XVIIIe siècles ainsi que le montrent Nicholas Turner, Stephanie S. Dickey et David de Witt (243). Turner aborde la récupération par le Guerchin de motifs de ses propres œuvres ; Dickey s’intéresse au dessin comme une pratique centrale de la vie d’atelier chez Rembrandt et chez Carrache ; enfin, De Witt trouve la source d’inspiration d’un dessin de Philips Koninck parmi les œuvres de la collection de Rembrandt. On pourrait interroger la pertinence du dernier article, celui de Pierre de la Ruffinière du Prey, s’il n’était pas placé à la toute fin. En effet, loin de la Renaissance, il étudie le passage d’un motif d’une sculpture des jardins du Boboli de Florence à un croquis de William Chambers, architecte anglais du XVIIIe siècle, jusqu’à un dessin architectural de son apprenti, John Yenn. Bien que son champ d’étude soit plutôt éloigné du propos du livre, les thèmes dont il traite – l’importance du dessin dans le travail d’atelier et son rôle dans l’apprentissage des étudiants – permettent à son article de faire à la fois office de synthèse et d’ouverture à la publication, en montrant comment ces enjeux du médium à la Renaissance se perpétuent bien après la fin de cette période. Ces thèmes figurent d’ailleurs au cœur de la recherche sur le dessin depuis plusieurs années. L’importance du dessin dans le travail préparatoire et la vie d’atelier, tel qu’abordée par Hochmann, Gregory, Ng, Gottwald et Dickey notamment, a été étudiée en profondeur sous l’angle de la « variante » dans l’ouvrage L’atelier du dessin italien à la Renaissance : variante et variation (2003) de Lizzie Boubli. Valérie Auclair s’est aussi intéressée à cette question pour le dessin français des XVe et XVIe siècles dans Dessiner à la Renaissance : la copie et la perspective comme instruments de l’invention (2010). Le rôle joué par le dessin dans les pratiques d’atelier de manière plus générale a de surcroît été analysé par Christopher S. Wood dans un essai publié au sein du livre Inventions of the Studio : Renaissance to Romanticism (2004). Ainsi, à la lumière de l’historiographie récente, le présent recueil constitue une synthèse intéressante des principaux enjeux du dessin à la Renaissance plutôt qu’une publication innovatrice, comme l’est par exemple Drawing Acts : Studies in Graphic Expression and Representation (2002). Écrit par David Rosand, professeur émérite de l’Université Colombia décédé en 2014, cet ouvrage s’attarde à la dimension phénoménologique du dessin, et donc à l’expérience – gestuelle – du dessin pour l’artiste, comme pour le spectateur. Des approches qui renouvelleraient véritablement l’étude du dessin sont rares dans le présent volume. Il convient donc d’interroger la pertinence du mot « Rethinking » dans le titre Rethinking Renaissance Drawings. Certes, quelques articles apportent une contribution importante (Stowell, Ng, Hoeninger et Dickey), mais plusieurs des auteurs demeurent trop en surface dans le traitement de leur problématique. Deux essais rendent même compte de projets encore en cours. Ron Spronk décrit son projet de recherche actuel, celui de constituer une banque numérique des dessins de Bosch, afin de permettre l’étude comparative de dessins conservés aux quatre coins du monde. Bien que les retombées scientifiques de ce projet soient prometteuses et que cet article permette de saisir concrètement l’héritage laissé par McTavish à l’Université de Queen’s où Spronk enseigne également, il ne présente pas véritablement de résultats et sa publication dans un ouvrage de ce type paraît peut-être un peu prématurée. Il en va de même de la contribution de Sebastian Schütze, qui se limite à la présentation de la figure du collectionneur Benno Geiger, sa collection – dispersée lors de la crise économique de 1929 – étant en cours de reconstitution. Ces quelques critiques s’expliquent sans doute par les contraintes éditoriales auxquelles ont dû se plier les auteurs. Le grand nombre d’auteurs ayant répondu à l’appel d’Una Roman d’Elia a sans doute restreint au passage l’espace accordé à chaque contribution – rares sont les essais d’une longueur de plus de dix pages. Le résultat est toutefois un livre aéré, qui se lit et se comprend facilement. Les nombreux articles sont organisés dans cinq sections clairement identifiées et présentées, à la fois dans l’introduction générale de l’ouvrage et dans une page introductive qui précède chacune d’elles. La limpidité de l’organisation permet de faire ressortir explicitement les thèmes principaux. De plus, une place importante est consacrée aux illustrations – 147 œuvres sont reproduites en couleur –, ce qui permet une compréhension approfondie des idées discutées dans les textes. En somme, ce livre agréable à lire comme à regarder permet de rendre à David McTavish les honneurs qui lui sont dus en présentant et en faisant comprendre clairement les enjeux des recherches actuelles sur le dessin à la Renaissance dont il est l’un des principaux instigateurs. Fannie Caron-Roy est doctorante en histoire de l’art à l’Université de Montréal et s’intéresse aux rapports entre art et dévotion privée dans la Rome de la Contre-Réforme. Vertical Divider
|

|
|
|||
|
|