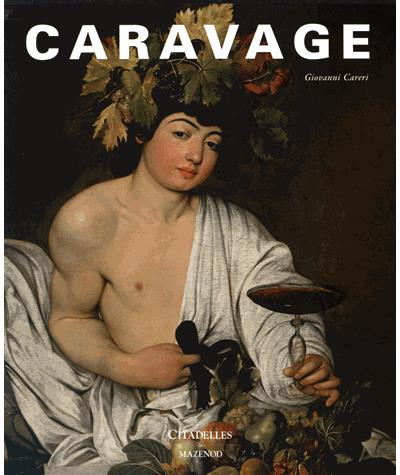|
Giovanni Careri
Caravage : La peinture en ses miroirs Paris, Citadelles & Mazenod, 2015 384 pp., 325 illus. coul Relié 189 €. ISBN 9782850886416 Qu’est-ce qu’un « ouvrage de référence » sur un peintre? Comment sait-on qu’on a entre les mains ce qu’en anglais on appellerait « the definitive account », nous donnant, pour un temps, le fin mot sur la carrière d’un artiste? La question est épineuse, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’un peintre – Caravage – sur lequel tout semble avoir déjà été dit, un artiste qui est l’objet d’un véritable déluge de publications depuis une vingtaine d’années. Le nouveau Caravage de Giovanni Careri donne plusieurs indices de sa candidature sérieuse à être désormais l’ouvrage de référence – en français à tout le moins – sur le peintre lombard. Le titre tout d’abord : c’est tout simplement le nom de l’artiste qui apparaît sur la couverture, même si un sous-titre, dont je parlerai plus loin, apparaît sur la page de garde et spécifie l’angle d’attaque choisi par Careri. Le format du livre exprime lui aussi sa prétention à un statut de « référence » : c’est un objet extrêmement beau, difficilement manipulable tellement il est grand et lourd, et il inclut une iconographie d’une qualité sans précédent dans les publications sur Caravage, que ce soit pour le nombre d’œuvres reproduites – pratiquement toutes les peintures du corpus de l’artiste, y compris de nombreuses attributions débattues, en plus de dizaines d’œuvres d’autres artistes servant comme points de comparaison – ou pour la qualité des reproductions et des détails agrandis et magnifiés. C’est donc un répertoire d’images sans égal sur papier, et une référence incontournable pour quiconque voudrait examiner les œuvres de Caravage sans pouvoir se déplacer jusqu’aux originaux. Enfin, le nom même de l’auteur promet un récit « définitif » puisqu’on lui reconnaît des ouvrages majeurs sur des artistes dont les liens avec Caravage sont d’une grande importance historique et conceptuelle, tels que Michel-Ange et le Bernin. D’ailleurs, Careri reprend ici, à grand profit, quelques idées maîtresses de sa pensée, développées dans ces écrits précédents. Un exemple frappant est l’insistance sur l’utilité du concept de montage, emprunté à l’analyse cinématographique, pour comprendre des œuvres baroques – des ensembles multimédia comme ceux du Bernin d’abord, mais aussi, comme on l’apprend ici, de « simples » peintures. Cependant, le Caravge de Careri refuse, par quelques autres aspects, de jouer le jeu de « l’ouvrage de référence ». D’abord, si toutes les œuvres communément attribuées à Caravage sont traitées dans ce livre, certaines sont mentionnées presque en passant, sans trop s’y attarder – elles sont, cependant, toujours magnifiquement reproduites – alors que d’autres font l’objet d’une analyse détaillée, comme c’est notamment le cas de L’incrédulité de saint Thomas, avec laquelle commence le livre et qui a droit à un chapitre à elle seule, hors cadre chronologique. Careri détermine l’ordre des analyses et leur dosage selon ses intérêts propres et pourrait décevoir les lecteurs qui s’attendent à tout apprendre sur toutes les œuvres. Le même choix est fait pour les références bibliographiques ; certes, l’exhaustivité dans le cas d’un peintre sur-étudié comme Caravage est tout simplement impossible, mais même en prenant cela en compte, la liste de références consultées est ici relativement maigre, comme l’est l’appareil de notes. Parmi les centaines, ou plus probablement les milliers de textes de niveau académique qui ont Caravage comme objet principal, sans parler des innombrables études sur les contemporains du peintre, sur son époque, la société romaine qui l’a accueilli, la théologie post-tridentine, etc., Careri fait un tri hautement sélectif : en tout et pour tout, moins de quatre-vingt-dix références sont nommées. Deux de ce nombre sont, de l’aveu même de l’auteur, particulièrement fondamentales pour son étude : Caravaggio and Pictorial Narrative : Dislocating the Istoria in Early Modern Painting de Lorenzo Pericolo, et The Moment of Caravaggio de Michael Fried (qui vient de sortir en traduction française). Deux « guides » assez peu conventionnels : si le livre de Pericolo a été très bien accueilli par les spécialistes de Caravage, malgré des débats sur la validité définitive de sa grille interprétative, Fried reste un personnage hautement controversé : une vedette de la discipline, spécialiste d’abord de l’art contemporain, qui depuis quelques décennies ose aller de plus en plus loin dans le passé et dont les excursions dix-septiémistes sont souvent critiquées, pour de bonnes et de mauvaises raisons à la fois. Careri mentionne la dette qu’il a envers ces deux collègues explicitement, et se réfère souvent, en effet, à leurs ouvrages respectifs. Mais il s’en démarque clairement aussi : comme il l’explique, son approche, à la différence de celle de Pericolo, consiste « dans la recherche d’un sens, à chaque fois spécifique, d’un travail de disjonction narrative qui, pour être remarquablement moderne et autoréflexif, n’est pas, pour autant, une fin en soi puisqu’il s’applique à la narration, à la présentation, à l’interprétation de l’histoire sainte et à son actualisation touchant des questions anthropologiques fondamentales et notamment la position du sujet chrétien par rapport au divin » (p. 194). Quant aux interprétations de Fried, celles-ci sont clairement trop idiosyncratiques, et liées trop aux propres intérêts du théoricien et trop peu à la Rome baroque, pour être suivies telles quelles par Careri. Mais les ouvertures théoriques de Fried réussissent à creuser des brèches dans le champ des études sur Caravage, et Careri s’y faufile volontiers. Une dette moins récente mais tout aussi évidente est envers Louis Marin, dont Careri fut l’élève, et surtout son magistral Détruire la peinture. L’analyse de la Méduse, notamment, suit les pistes fertiles proposées par Marin, et réussit à les approfondir et à les mettre dans un contexte plus large, ce qui est un exploit majeur étant donné l’ampleur intellectuelle et l’originalité de l’ouvrage publié en 1977. Empruntant des observations à tous ces chercheurs, et à quelques autres, Careri lui-même propose, en fin de compte, un angle particulier à lui : son ouvrage n’offre pas simplement un récit chronologique de la vie et de l’œuvre de Caravage, comme on a appris à s’y attendre d’un « ouvrage de référence », mais propose, au contraire, une interprétation cohérente, spécifique et originale du projet artistique caravaggesque. Ce point de vue est résumé par le sous-titre bien discret du livre : La peinture en ses miroirs. Caravage est étudié en relation avec certains de ses contemporains – d’autres peintres comme Annibal Carrache, mais aussi des écrivains tels que Marino ou le Tasse, dont Careri est un grand lecteur – qui, comme lui, mènent « une élaboration théorique […] autour de la question du sujet, dans sa relation à une réflexivité omniprésente dont le miroir est souvent l’opérateur » (p. 67). Les miroirs au sens propre du mot sont assez rares chez Caravage, et n’ont pas la place centrale qu’ils peuvent avoir chez d’autres artistes contemporains – comment ne pas penser à Velázquez ! Careri nous montre de manière très convaincante, toutefois, à quel point tout l’art de Caravage est construit autour de l’idée du reflet, de l’écho, du doublement. Le miroir est non seulement un outil de travail, nécessaire pour les nombreux tableaux incluant un autoportrait du peintre ou pour ceux qui insinuent dans la posture des personnages une attitude similaire à celle de l’artiste tenant sa palette et son pinceau ; le miroir est aussi et surtout un concept qui fait de ces peintures des laboratoires de la subjectivité. Les actes de violence représentés par Caravage sont un exemple d’un tel traitement de la constitution du sujet où « la représentation de l’acte violent se double presque toujours d’un moment d’introspection et donc de l’émergence d’une subjectivité surgissant au cœur même de l’action » (p. 338). Partant de ce constat, ou plutôt parallèlement au travail heuristique qui finit par produire cette interprétation générale, Careri nous offre une richesse infinie d’analyses, d’observations au sens le plus littéral du mot : il regarde les peintures si attentivement, que certaines des choses qu’il y voit surprendraient, je pense, même les lecteurs qui regardent ces œuvres depuis des années (j’en suis). Tant de perspectives sont ouvertes ainsi pour la future recherche sur Caravage, qu’au lieu de nous donner « la version définitive », l’auteur nous ouvre tout un champ à labourer. Careri prend les œuvres de Caravage très sérieusement comme « objets théoriques » à la Hubert Damisch, mais il les traite avant tout comme des objets très concrets du regard. Et en fin de compte, y a-t-il autre chose que l’histoire de l’art doit faire, une plus belle vocation pour elle que de nous faire voir des liens, des échos, des détails dans des œuvres que l’on croirait connaître par cœur? Dans ce domaine-là, Careri est un maître quasi inégalable. Et en effet, c’est là son objectif avoué, c’est là sa méthode pour réaliser ce qu’il veut faire : comme il le dit très explicitement, il souhaite « laisser parler les tableaux » (p. 367), « mettre d’abord en avant l’efficacité de la peinture elle-même, la puissance de son effet propre, au lieu de l’expliquer par le contexte historique et biographique » (comme on l’a déjà vu, le contexte historique n’est pourtant guère négligé) ; et « mettre les effets de peinture au cœur de [s]a réflexion, tout en situant la relation avec le spectateur au centre de l’analyse » (p. 49). Et s’il n’est pas toujours clair qui est ce spectateur et surtout à quelle époque il vit, il reste que c’est justement cette ambiguïté (parle-t-on des Romains de 1600 ou des lecteurs de 2016 ?) qui finit par nous convaincre de cette efficacité de la peinture, de son pied de nez à l’orthodoxie historiciste et de son ouverture, souvent célébrée de nos jours en histoire de l’art en général, à un anachronisme productif. Une telle approche est non seulement inspirée et inspirante ; elle est aussi, soulignons-le, un antidote extrêmement utile dans un domaine d’étude depuis longtemps emprisonné dans – et empoisonné par – le biographique, l’anecdotique et le scandaleux, éléments que la vie de Caravage semble offrir si généreusement. Si les publications relativement confidentielles destinées aux « spécialistes » arrivent souvent à faire vraiment de l’histoire de l’art plutôt que de s’empêtrer dans le psychodrame phantasmatique de la vie du peintre, les productions « grand public » – les textes accompagnant les si nombreuses expositions organisées autour de Caravage en premier lieu, mais aussi les films et les romans le prenant comme sujet – tombent allègrement dans le piège considérant ce peintre comme l’archétype de l’artiste maudit et ne voient dans les œuvres que leur drame extravagant et leur érotisme éhonté. Un antidote plus discret mais tout aussi important, à mon sens, se trouve dans l’explication que donne Careri au fameux « réalisme » de Caravage, un concept omniprésent mais rarement examiné sérieusement. Ce prétendu réalisme est au centre des débats théoriques sur le peintre, mais il est utilisé encore plus souvent, et presque toujours à mauvais escient, dans les textes de vulgarisation. Comme l’explique Careri, « le “réalisme” de Caravage ne consiste ni dans le rendu illusionniste des objets et des corps ni dans la simple introduction dans ses tableaux de personnages du peuple » ; or, c’est exactement là, comme l’auteur l’indique de manière si perspicace, que d’innombrables textes situent le réalisme, voyant en Caravage un peintre qui représente « la réalité telle qu’elle est », comme si c’était si simplement envisageable. Et à cette critique l’auteur ajoute une explication positive du réalisme, qui sauve, en quelque sorte, la pertinence du concept, au moins pour les tableaux à thème religieux : « Il s’agit plutôt d’un “réalisme chrétien” au sens d’Auerbach, à savoir la construction du corps charnel, terrestre et mortel dans lequel le divin a choisi de s’incarner, accordant ainsi à cette corporéité une valeur et une dignité inédite » (p. 261). C’est comme si à la revalorisation du corps humain à la Renaissance, suivant les modèles classiques païens, s’est greffé enfin avec bonheur le message chrétien de l’incarnation, fusionnant deux univers que les artistes du quattrocento et du cinquecento ont cherché longtemps à réconcilier : cette fusion sera la réussite fulgurante du Baroque naissant, porté par la Contre-Réforme, et de Caravage d’abord. Il me fait de la peine de terminer la recension d’un ouvrage si ambitieux et véritablement excellent par un reproche qui peut sembler mesquin, mais qui à mon avis a de l’importance, puisqu’il montre à quel point le monde de l’édition universitaire se trouve sur une pente glissante : nous le savons tous, les maisons d’édition universitaires peinent, à quelques exceptions notables près, à trouver les moyens pour faire leur travail éditorial sérieusement. Trop souvent, en particulier dans le monde francophone, ce travail si important est laissé au soin des auteurs, dont la formation et la vocation sont autres. Dans le cas du Caravage de Careri, on regrette fortement qu’un objet aussi beau et un texte aussi important, voué à devenir, si ce n’est l’ouvrage de référence, à tout le moins une des références majeures dans le domaine, n’ait pas fait l’objet d’un travail de révision et d’édition plus rigoureux. Ainsi, l’historien de l’art Todd Olson, mentionné de nombreuses fois, devient systématiquement Olsson ; les légendes d’un Pontormo et d’un Rosso sont inversées, comme le sont quelques mains gauches et droites ; de nombreuses virgules sont mal placées, les coquilles abondent, et trop de phrases sont mal construites. On peut espérer que dans une prochaine édition, le travail iconographique remarquable sera accompagné d’une révision linguistique à la hauteur de cet ouvrage, originalement écrit en français, que l’on espérait depuis longtemps, et que l’on a enfin le plaisir de lire et de citer. Itay Sapir est professeur d’histoire de l’art européen (XVIe-XVIIe siècles) à l’Université du Québec à Montréal. Vertical Divider
|

|
|
|||
|
|